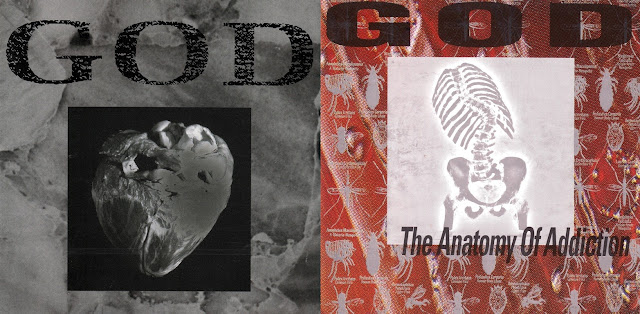Il ne me semble pas nécessaire d’être un
fanatique absolu de Disappears pour apprécier FACS à sa juste valeur. Je m’explique : dans les premiers on
retrouve le guitariste/chanteur Brian Case (ex 90 Day Men* mais également
auteur de brillants albums en solo **) ainsi que le guitariste Jonathan Van
Herik, le bassiste Damon Carruesco et le batteur Noah Leger*** ; enlevez
Carruesco parti pour d’autres horizons professionnels et vous obtenez Facs. Il ne s’agit pas du même groupe
changeant simplement de nom par respect envers un ex membre puisque il
semblerait que Disappears soit en fait en hiatus pour une période indéterminée c’est
à dire qu’il serait toujours possible qu’un jour le groupe de Chicago refasse
surface ; en attendant Facs est
donc bien un projet tout nouveau visant à explorer d’autres chemins, en tous
les cas visant à explorer différemment les chemins d’un post punk aussi sombre
que sobre et, élément nouveau, aussi minimaliste qu’accidentogène.
Évidemment les amateurs de Disappears
n’ont pas été déçus par Facs étant
donné qu’il y a d’indéniables similitudes entre les deux groupes. Mais on trouve
aussi quelques différences notables. La première d’entre elles concerne Brian
Case qui est le bassiste du nouveau trio et non pas son guitariste. C’est du
moins le cas sur Negative Houses, le
premier album de Facs, les parties
de guitares y étant assurées par le seul Jonathan Van Herik. Un changement qui peut
en partie expliquer pourquoi le trio s’applique davantage à jouer une musique
aérienne et mouvante, sorte de rock noisy et planant qui opère en empilements irréguliers de surcouches brumeuses se chevauchant élégamment. Les lignes de
basse prennent une place particulière, loin de se cantonner dans un rôle
rythmique (le très anxiogène Just A
Mirror), rappelant que le nom complet de cet instrument est « guitare
basse » et qu’en tant que tel il s’agit bien d’une guitare égrenant notes
angoissées ou tentatives mélodiques avortées. Un instrument qui occupe donc une
place centrale (on n’en attendait pas moins de Brian Case), jouant le rôle de
pivot et contaminant tout le reste, à commencer par la guitare qui agit par
à-coups, privilégiant les arrière-plans bruitistes aux ritournelles
mémorisables (comme le final industriel et éprouvant de All Futures). Ce qui confère souvent à Negative Houses un côté décousu rendant le post-punk de Facs complètement atypique parmi tous
les groupes revivalistes actuels qui trop souvent ne retiennent que le côté « punk »
de la chose.
Exit
Like You tempère néanmoins ce qui vient d’être dit : il
s’agit de l’un des titres parmi les plus classiques de l’album, celui où la
basse est une vraie basse et où la guitare balance un gimmick dont on attend
sans cesse qu’il revienne, transformant Exit
Like You en hit crépusculaire et en machine à danser façon robot immobile. Silencing est encore plus évident et complètement
tubesque, replongeant l’auditeur dans les méandres de la musique des années 80
sans toutefois le côté complaisant de la noirceur trop facilement partagée.
Quant à Skylarking, voilà une
composition qui fait le lien entre le côté mélodique/mémorisable de Facs et l’aspect plus expérimental/perturbateur
de la musique du groupe. Définitivement à part, Houses Breathing accueille le saxophone de Nick Mazzarella qui livre une
performance magnifique et qui prend beaucoup de place, éloignant Facs de son minimalisme théorique et
ouvrant la voie à une luxuriance inquiétante – même si musicalement les deux
groupes sont éloignés l’analogie avec les anglais de Bauhaus s’impose puisque
rares sont les groupes rock ou électriques à avoir su gérer les
instruments à anches sans tomber dans le kitsch de la décoration d’intérieur
pour cavernes et vieux hangars hantés.
Depuis l’enregistrement et la parution
de Negative Houses de nombreux
changements ont encore eu lieu du côté de la petite bande de Brian Case :
Jonathan Van Herik a quitté Facs et
son poste de guitariste a alors été repris par Case tandis que celui de
bassiste dorénavant vacant est revenu à la nouvelle venue Aliana Kalaba. Par conséquent il y a
de bonnes chances pour que Negative
Houses soit le seul unique album de groupe à posséder ce nuancier si
particulier et ce type de compositions subtilement perturbées. Et puis, par
truchement, le départ de Jonathan Van Herik de Facs entérine indirectement et un peu plus la cryogénisation prolongée
de Disappears. Nous verrons bien… en tous les cas, fin définitive ou simple
pause, cela a permis à Facs
d’émerger et de donner à en entendre ce plus qu’intrigant Negative Houses et c’est déjà beaucoup.
[Negative Houses est publié en vinyle doré ou noir par Trouble In Mind records]
* dont seul le premier album (Is (is) It) Critical Band est
aujourd’hui encore recommandable et écoutable, To Everybody étant tout juste sauvable et Panda Park méritant purement et simplement le lance-flammes
** ceux-ci sont notamment publiés par
l’excellent label Hands In The Dark : Spirit Design ou plus récemment Plays Paradise Artificial
*** à l’origine c’est Steve Shelley de
Sonic Youth qui tenait la batterie dans Disappears, ce qui a sans doute boosté
le début de la carrière du groupe mais n’a heureusement pas duré trop
longtemps, permettant à Desappears de se faire un nom grâce à sa seule musique